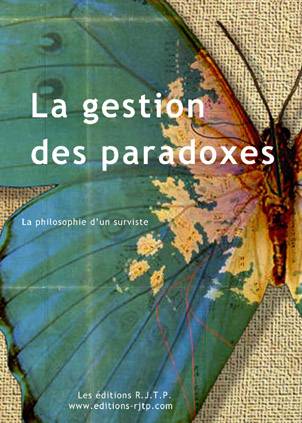|
L'être
supérieur
Paradoxe
: Etre supérieur, c'est être esclave.
Le
mythe, le rêve, et la réalité.
Suite
à l'épisode « nazisme » qu'a connu l'humanité,
l'expression « être supérieur » est devenue
tabou.
Pourquoi
un tel tabou ?
Parce que l'information
« être supérieur » ou « être inférieur
» est d'une part associée (dans les cerveaux connaissant
l'histoire de l'humanité,) à « guerre mondiale,
chambre à gaz, camps de concentration, morts, etc » (informations
classées dans « survie menacée »),
d'autre part, notre
ego est généralement fier de lui, nous avons du mal à
admettre que l'on puisse se tromper, et nos voisins nous semblent souvent
« imparfaits » pour tel ou tel comportement. Or, si quelqu'un
nous paraît « imparfait », c'est que nous nous sentons
quelque part « supérieur ». En termes clairs, nous
sommes des êtres supérieurs face à «l'abruti
de voisin ou de voisine ». Seulement, nous n'osons pas le dire
haut et fort, ayant un peu honte de cette impression prétentieuse
de supériorité.
Mais cette notion d'être
supérieur est en chacun de nous depuis la nuit des temps qu'on
le veuille ou non. L'humain vit en société, il affronte
des dangers, il se compare à ses semblables et certains humains
sont plus forts, plus capables que d'autres, il se crée alors
naturellement une hiérarchie « du plus faible au plus fort
».
Le tout étant
dirigé par le principe de la survie qui sanctionne l'imperfection
ou plutôt, l'inadaptation.
Le
tabou naît donc de ces valeurs paradoxales : il y a un danger
à parler de « la supériorité », mais
elle existe et il faut gérer cette notion.
Malgré
ce tabou, la notion d'« être supérieur » n'a
pas pour autant disparu.
Les
vendeurs de super héros (dans les jeux vidéos, les films
ou d'autres supports) se servent en permanence de ce mythe de l'être
supérieur pour donner l'envie au consommateur d'être à
son tour un « être supérieur » (en consommant
le produit de la publicité) « Vous avez acheté
ce produit ? Cette voiture ? Oh, alors vous êtes quelqu'un
de formidable, d'intelligent, etc ».
Qui n'a pas rêvé
d'être Superman ou Superwoman, d'avoir des pouvoirs qui vous fassent
sortir du lot qui vous permettent de sauver le monde ! Et cette recherche
ne se limite pas au rêve car les politiciens, les juges, les militaires,
etc. ont toujours en eux cette jouissance d'être au dessus, d'être
différents en mieux.
Seulement, ils n'utilisent
pas ces termes expressément, donc, « tout va bien ».
La
notion d'être supérieur existe dans nos cerveaux, fait
partie de nos rêves cachés, mais faute de communication
claire, cette notion est la porte ouverte à toutes les « conneries »
du genre :
deviens un être
supérieur en faisant partie d'un groupe spécial (discours
des sectes) ou en achetant tel ou tel produit.
Alors
comment définir un « être supérieur »
? Supérieur par rapport à quoi ?
Par
rapport à la moyenne de nos semblables ?
Est-ce
utile de définir qui est « un être supérieur
» qui ne l'est pas ?
Faire
une liste est totalement idiot pour la simple et bonne raison que notre
supériorité éventuelle est toujours liée
à un moment précis (car nous ne sommes pas en permanence
au top de notre forme et de nos capacités), et à un domaine
précis (la personne ayant d'immenses connaissances dans le domaine
de l'astronomie pourra en même temps être incapable de se
faire la cuisine).
La
supériorité est par définition, « une meilleure
aptitude à assurer notre survie ».
Encore
un paradoxe : faire des erreurs amène à la supériorité.
Ces
dernières nous servent de repères, elles nous servent
de leçons (lorsque l'on subit un échec, généralement
on s'en souvient), elles nous permettent d'apprendre comment il faut
faire les choses pour qu'elles fonctionnent bien et donc de nous améliorer
(de devenir un être supérieur à l'être que
nous étions dans le passé)
Il est par conséquent
totalement idiot de nous empêcher de faire des erreurs.
L'exemple classique qui montre que l'erreur participe à
notre survie :
la pénicilline est un médicament qui a été
trouvé suite à une mauvaise manipulation. (une éprouvette
a été mal nettoyée et la présence de résidus
d'un champignon a empêché le développement de bactéries.
De cette constatation, de cette imperfection de nettoyage, la découverte
a été possible. Et cette découverte a été
une grande avancée pour l'humanité.)
Un
enfant a beau savoir qu'il ne faut pas faire certaines bêtises,
il sera souvent tenté de les faire histoire d'établir
ses propres limites, de constater par lui-même et ainsi de comprendre
pourquoi on qualifie de bêtises certains comportements.
«
Etre supérieur » veut-il dire :
« je sais ou fais mieux que les autres, donc je suis en droit
de diriger les autres »
?
Si
un père impose ses règles (à tort ou à raison)
à ses enfants, c'est parce que dans sa tête il se sent
supérieur à sa progéniture. Lorsque la progéniture
n'est pas majeur, il est normal qu'un adulte « guide »
ses enfants. Le parent sert de jalon dans un monde trop immense et trop
rempli de dangers.
Jusque là, rien
de fondamentalement anormal, même si certains pourraient préférer
que les règles soient comprises de l'enfant au lieu d'être
simplement imposées par une quelconque violence.
Mais lorsque l'enfant
est adulte, le parent a-t-il encore une légitimité à
imposer son point de vue ?
Certains
parents ont cette impression persistante qu'ils seront toujours supérieurs
à leur enfant puisqu'ils auront toujours vécu plus longtemps,
auront toujours plus d'expérience que leur enfant.
Sauf que de son côté,
l'enfant vit ses propres expériences, accumule du savoir que
son parent n'a pas forcément vu qu'ils ne vivent pas forcément
exactement la même chose.
Devoir couper le cordon
est parfois dur à admettre pour le parent qui « a
trop peur » de ne pas maîtriser son avenir. L'avenir
de l'enfant ou son avenir ? C'est là le problème :
Encore
un paradoxe : je suis « moi », mais en lui
ou elle, je suis aussi moi...
« moi
= lui ou elle ». « Son avenir, c'est mon avenir ».
Et
lorsque l'on oublie que l'individu est un individu unique, libre, indépendant,
on arrive rapidement aux conflits : « fais ceci, ne
fais pas cela ».
L'être
supérieur est-il un être inférieur ?
Autre cas :
Si un homme impose
sa loi à une femme, c'est pour le bien de qui ?
En
considérant que l'homme est « équivalent en
droits » à une femme,
si un homme dit que
la femme doit avoir tel ou tel comportement, et sera punie si elle n'agit
pas ainsi, il devrait pouvoir accepter qu'une femme lui dise qu'il doit
avoir tel ou tel comportement et qu'il sera puni de la même manière
s'il transgresse les règles.
Or
ce n'est pas le cas.
Pourquoi ce n'est pas
le cas ? Si l'homme est supérieur alors il peut respecter
les mêmes règles qu'une femme ! Il peut même
respecter des règles encore plus contraignantes !
Il n'y a que les « bêtes » qui ne respectent
pas des règles complexes !
Que
montre ce paradoxe ?
Ce paradoxe montre
que certains hommes imposent leurs lois à certaines femmes non
pas parce qu'ils sont supérieurs, mais parce qu'ils sont inférieurs.
« Pour
cacher mon infériorité, je prétends que je suis
supérieur ».
Ces
hommes ont peur de ne pas maîtriser les autres, ils ont peur que
les autres deviennent un danger, et seul l'attribution aux autres d'un
statut d'esclave peut les rassurer (un statut d'esclave pour les femmes,
et un total mimétisme imposé aux hommes).
Si un être est
réellement supérieur il ne devrait pas avoir peur d'un
être dit « inférieur ». Un être
supérieur est au dessus de toutes menaces.
Mais en réalité, le soi-disant être inférieur
a par moment une capacité à menacer l'être soi-disant
supérieur, et c'est pour faire face à cette menace que
ce dernier utilise la violence, l'imposition de règles contraignantes.
Si un être a une capacité de « menace », c'est
qu'il n'est pas inférieur, mais supérieur par moments.
Et s'il est supérieur, pourquoi devrait-il obéir à
un être « inférieur » ?
Encore
un paradoxe montrant bien que ces notions de supériorité
et d'infériorité n'aident pas vraiment à vivre
lorsqu'elles qualifient des êtres entiers, de catégories
d'êtres humains classés suivant leur sexe, leurs valeurs
prioritaires, leurs religions, etc.
Supériorité
et survie,
plus de subtilités que l'on croit.
Il
est très important de parler de ces notions de supériorité
et d'infériorité car elles sont souvent très vite
associée à la notion de survie et déborde sur le
« qui a le droit de vivre ». Mais la survie étant
une chose très subtile, elle ne fait pas bon ménage avec
les étiquettes de « supériorité » et
« d'infériorité ». Pourquoi ?
Comme on l'a vu précédemment,
la supériorité d'une décision (dont la conséquence
est une survie mieux assurée qu'une autre) est toujours remise
en question par le temps qui passe et qui amène de nouveaux paramètres,
remettant en question la justesse de la prise de décision anciennement
« supérieur ».
D'un
point de vue humain, il est également évident que la supériorité
d'un humain sur un autre est toujours fort relative. Oui, les capacités
physiques peuvent être quantifiées et donc classées
(par exemple en chronométrant une course). Mais ces classements
évoluent en permanence et « celui qui est au top »
finit toujours par ne plus l'être. Même chose pour les capacités
intellectuelles, on finit toujours par « être le con de
quelqu'un », les domaines de compétences sont si nombreux
qu'il est humainement impossible d'être au top dans tous les domaines
(lorsque ces domaines sont richement fournies en données, je
ne parle pas des enseignements dispensés dans les écoles
où ces données sont limitées à un programme).
Et
pourtant, malgré ce piège qu'est le mot « supériorité »
il est important d'
Oser
dire où est l'infériorité
Si
la supériorité a pour définition : capacité
à assurer au mieux sa survie,
l'infériorité
a pour définition : capacité à ne pas assurer
sa survie.
Et
l'une des infériorités communément rencontrée
par l'humain, c'est... « La connerie ».
(Je parle de la connerie
que l'on prend par erreur pour une vérité (exemple :
dire que la terre est plate) et non de la connerie prise pour.. de la
connerie (type de connerie utilisée par exemple dans les spectacles
comiques).
Une
« connerie » est ce qui qualifie ce qui n'assure
pas notre survie, qualifie une forme de danger, et malgré la
bienséance, il faut savoir appeler un chat un chat, et une connerie :
une infériorité mentale.
Grâce à
l'identification de cette « infériorité mentale »
on peut réagir et éviter le danger.
Exemple :
une attitude qui pollue l'environnement (rejeter des polluants dans
la terre) est une infériorité mentale.
Mise
en garde : un humain qui produit une infériorité
mentale (en langage clair : un humain qui agit comme un con) n'est
pas « un con » quoi qu'il fasse, n'est pas un
« être inférieur permanent ».
La supériorité
comme l'infériorité est une réalité du moment,
liée à un événement.
L'infériorité
mentale se « soigne » par la connaissance, par
la prise de conscience.
La supériorité
mentale ne donne aucun droit ou pouvoir sur les autres, mais au contraire
implique sa mise à disposition d'autrui, une servitude humble
au profit de l'avenir de la race humaine.
Combien
d'être « soi-disant plus intelligent que les autres »
finissent
par s'autodétruire ?
Cet
état de fait montre que la supériorité des capacités
est toujours relative, et que la supériorité est plus
dans un état d'esprit, une philosophie de vie définie
et résistante aux épreuves. Sans philosophie de vie, l'humain
n'est pas grand chose.
«
pas grand chose », donc un être inférieur ?
Momentanément
en tout cas, aussi momentanément que lorsqu'il se sent supérieur.
La conscience (la prise en considération correcte des éléments
en présence) permet de relativiser autant dans un sens que dans
l'autre.
Ne
pas se prendre pour un dieu, ne pas se prendre pour une fourmi insignifiante,
est-ce que le bonheur ce serait d'« être moyen » ?
Dans la banalité ?
On
l'a vu précédemment, le bonheur ne peut pas être
un point précis (avec une liste établie d'éléments)
parce que le bonheur est une impression du cerveau lorsque les éléments
qui l'entourent lui indiquent que « la survie est pleinement
assurée », un peu comme « l'amour »
(sauf que « l'amour » est une étiquette
généralement posée sur quelque chose de vivant
alors que « le bonheur » est une étiquette
posée sur une réunion d'élément pas forcément
vivant).
Or, les éléments
qui nous entourent évoluent, ne serait-ce qu'avec le temps qui
s'écoule, et donc, le « point de survie pleinement
assuré » évolue lui aussi.
Le
bonheur, c'est un bateau qui ne prend pas l'eau.
Alors,
la banalité dans tout ça... C'est le secret pour que le
bateau flotte ?
Non.
La banalité est « un point (plus ou moins) précis »,
et comme tout point précis, il ne peut pas être une référence
pour un mental équilibré.
Autrement dit, pour
être « équilibré » il ne faut
pas être « dans un comportement extrême »
mais pas forcément non plus, attaché à une moyenne.
Le « brin
de folie » est nécessaire à la fois pour que
la « sécurité » ne se transforme
pas en prison, ainsi que pour « explorer d'autres terrains
que les siens »
Le bonheur « absolu »
n'est définitivement pas un état de fait permanent, une
liste ou un point précis.
Alors
les personnes insatisfaites en permanence, sont équilibrées ?
Sont « dans le bonheur » ?
Cela
dépend de la volonté et du désir.
Si une personne cherche volontairement à faire mieux, si cette
personne est « insatisfaite » sans que cela la
tourmente, si elle sait que le monde n'est qu'un changement permanent,
alors cette personne aura une philosophie de vie que l'on pourra qualifier
de « progressiste » (qui cherche à progresser).
Son bonheur est dans son insatisfaction relativisée.
Mais si cette personne
est insatisfaite en permanence sans savoir ce qu'elle veut, sans savoir
qui elle est (sans savoir quelles sont les valeurs profondes dans lesquelles
elle se sent bien), si cette « insatisfaction »
n'est qu'une fuite, alors la volonté et le désir n'existeront
pas, et cette personne vivra sûrement mal cet état, et
ne se sentira probablement ni heureuse ni équilibrée.
Oui,
logique, tout ceci n'est qu'un ensemble d'évidences !
Alors
pourquoi n'arrives-tu pas à savoir ce qu'est « le
bonheur » si tout est évident ?
Je
n'en sais rien.
Comme
me disait un prof de math, lorsqu'on pose correctement une question,
le travail pour trouver la réponse est déjà fait
en grande partie.. Alors « tu ne sais pas » probablement
parce que tu ne te poses pas les bonne questions.
Un
prof de math ? Mais l'humain n'est pas mathématique !
Ça
c'est une bonne question !
Ce
n'était pas une question mais une affirmation.
Il
faut toujours se méfier de ses certitudes. En particulier sur
ce qu'on est, car le recul nous manque souvent.
Je me suis posé
la question « n'y a-t-il pas une organisation dans nos pensées
? » ce qui m'a amené à découvrir que
la survie orientait absolument tous nos actes même ceux qui était
autodestructeur, mais ça m'a aussi permis de comprendre les valeurs
que chacun avait.
On a tous dans la tête
des informations comme « parents », « travail »,
etc.
Mais chacun met des
valeurs différentes à ces informations :
« les parents
c'est sacré », jusqu'à « les parents
sont de simples géniteurs », etc.
Je ne
voudrais pas être désagréable, mais... Et alors ?
Alors,
si quelqu'un menace quelque chose que tu aimes, ta survie sera menacée.
Si cette même
personne menace quelque chose qui t'est indifférent, tu ne réagiras
pas.
Mais
la réaction des gens n'est pas la même pour tous lorsqu'on
menace quelque chose qu'on aime ! Certaines agissent et deviennent
violente,s certaines bouillent à l'intérieur sans agir,
ce n'est pas pareil.
Oui,
mais creusons un peu les différences et voyons si les gens qui
osent réagir n'ont pas les mêmes caractéristiques.
Puis nous regarderons si les personnes qui ne n'osent pas réagir
n'ont pas les mêmes caractéristiques entre elles.
Prenons
un exemple concret :
Un individu mal intentionné
vol le sac d'une grand mère à quelques mètres devant
vous, et arrive sur vous.
Cet individu est grand
et à l'air musclé.
Lorsqu'il
passe à votre hauteur, il n'y a que deux choix possibles
:
Vous le laissez passer
ou vous essayez de l'arrêter.
Quelles
sont les informations présentes dans les deux cas :
« Vous
le laissez passer »
Tenter
d'arrêter cette personne représente un danger pour vous :
Vous n'êtes pas
assez musclé, vous ne connaissez aucune technique pour arrêter
une personne, vous connaissez des techniques mais vous n'avez pas confiance
en vous.
Vous ne vous sentez
pas concerné par cette agression / vous n'aimez pas les personnes
âgées, ou cette personne est laide => elle s'est fait
agresser ? Bien fait pour elle.
Vous
n'avez pas le temps de comprendre réellement ce qu'il se passe,
vous vous sentez comme dans un film donc pour vous l'agression n'est
pas réelle.
L'argent et les papiers
volés sont moins importants que la vie de la personne âgée.
Elle est toujours vivante, c'est le principal.
« Vous
essayez de l'arrêter »
L'agresseur
représente un danger pour la société et vous vous
sentez responsable en tant que membre de cette société.
L'agresseur est musclé
mais vous l'êtes plus, donc vous pouvez intervenir sans danger.
L'agresseur est musclé
mais vous connaissez des techniques de combat qui permettent d'immobiliser
n'importe qui, donc l'arrêter ne pose pas de problème.
L'agresseur est plus
fort que vous mais vous aimez vous confronter à l'impossible
et espérez être comme David contre Goliath.
Vous vous sentez plus
malin que lui et un simple croche-patte permettra à quelqu'un
ou un groupe de personnes d'intervenir plus facilement.
La haine de se genre
d'individu décuple vos forces et vous aveugle quant aux conséquences,
alors vous intervenez.
Les
réactions humaines sont parfaitement mathématiques, classables.
Mais il ne faut pas pour autant croire que l'humain peut se ranger dans
UNE boîte. L'humain est un ensemble de boîtes... Dont l'importance
bouge suivant les éléments auxquels il est confronté.
Parler
de « boîtes » pour la psychologie humaine
peut donner l'impression d'enfermement, de « chose préétablie qui
transforme la vie humaine en une destinée écrite d'avance »
mais cette impression n'est pas du tout justifiée car une boîte
a toujours une ouverture, sinon, ce n'est plus une boîte.
|