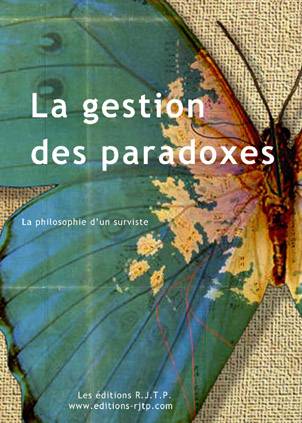| |
Intro
L'humain
veut tout, mais en ayant tout, il finit par se lasser.
Alors comment gérer nos paradoxes ?
En comprenant comment fonctionne
la mécanique humaine.
Introduction :
Pour ceux qui aiment les précisions, différentes définitions
et préambules.
Qu'est-ce que l'intelligence ?
Qu'est-ce qui reste vrai dans tout le bazar de notre
monde ?
N'y a-t-il pas un ordre prioritaire quelque
part ?
Qu'est-ce que le survisme ?
La philosophie surviste
Nuire aux sectes
La psychologie
Différence entre « penser mal »
et « mal penser »
La philosophie
Pourquoi ce livre ?
Se regarder en face est-il possible ? (intro)
Conscience égal impuissance ou puissance
? (intro)
Le cercle des profs disparus.
___
Pour ceux qui aiment les précisions, différentes définitions
et préambules.
Notre monde ne sera jamais davantage que ce que notre cerveau voudra
bien en voir et comprendre.
Alors comment être sûr que l'on ne se trompe pas ?
A-t-on le droit à l'erreur ? Comment gérer ses erreurs ?
Savoir que l'on ne sait rien
(ou presque)
Qu'est ce que l'intelligence ?
Le cerveau humain est fait pour tisser des liens entre les éléments
qui l'entourent. Le type de liens le plus répandu est celui de
cause à effet.
Exemple : Le père et la mère sont la « cause »
de l'existence de l'enfant.L'enfant est un « effet ».
Tout ce qui est présent autour de nous est un enchaînement
extrêmement complexe de causes et d'effets multiples.
Exemple : pour me déplacer j'utilise une voiture. Mais...-
avant de pouvoir utiliser cette voiture, il a fallu qu'une société
commerciale imagine et construise cette voiture.- mais avant que cette
société commerciale agisse, il a fallu que des inventeurs
fassent des découvertes dans le domaine de la chimie, de la géologie,
de la mécanique.- mais avant que ces inventeurs (ou découvreurs)
établissent leur découverte, il a fallu qu'ils reçoivent
une certaine éducation, un certain savoir.- mais avant que ce
savoir soit transmis, il a fallu le collecter, l'enregistrer dans des
livres.- mais avant que ces livres soient réalisés, il
a fallu inventer l'imprimerie, l'écriture, etc.
Puis après l'utilisation d'une voiture, d'autres effets ont été
générés :La pollution, le travail des réparateurs,
des hôpitaux, celui des recycleurs, etc.
Tous ces enchaînements sont certes complexes, mais il ne faut
pas se laisser submerger par ces complexités. En prenant son
temps et en communiquant, on peut arriver à isoler chaque élément
et à comprendre quelle est sa place dans l'ensemble. Le monde
n'est qu'un immense ensemble complexe de choses très simples.
La connaissance de tous ces enchaînements de causes et d'effets
s'appelle l'intelligence.Remarques : certaines personnes conçoivent
l'intelligence comme une action et non comme une somme de savoir. Il
est vrai que le savoir pour le savoir, (un livre posé dans une
bibliothèque poussiéreuse) n'est pas en lui-même
« intelligent ». Mais lorsque le mot intelligent
est le qualificatif d'un raisonnement, (que ce raisonnement soit fait
par une machine ou un être vivant), le mot « intelligent »
se définit par la capacité d'analyser, de reconnaître,
de comprendre, autrement dit, la capacité de maîtriser
des chaînes de causes et d'effets. Un humain qui comprend une
situation, mais qui ne réagit pas d'une manière ou d'une
autre, peut être qualifié également de « non
dégourdi », de « passif », etc.
Mais « dégourdi, passif » sont des qualificatifs
indépendants de « la compréhension ».
L'action, la réaction peuvent être empêchées
par d'autres paramètres comme « la peur de ne pas
avoir toutes les cartes en mains avant d'agir », par « le
désir de laisser les autres se débrouiller »,
ou tout simplement par paresse.
Peut-on être intelligent et trouillard ou paresseux ? L'un
n'empêche pas l'autre. L'intelligence n'est donc pas fonction
d'une action, mais d'une connaissance correcte des éléments
en présence.
Et les erreurs que l'on commet dans ces enchaînements de causes
et d'effets s'appellent (désolé pour le langage non châtié)
« la connerie ».
La connerie peut être
volontaire, mais la plupart du temps elle est involontaire.
Dans ces conneries involontaires,
il y a encore un autre stade de danger :
la connerie que l'on prend pour « vérité »
et qui sert de base à l'organisation de notre vie.
Alors dans tout ce qui nous entoure, comment faire le tri entre « la
connerie » et « l'intelligence » ?
Il faut déterminer où est la réalité en
prenant en compte tous les avis possibles et différents.
Exemple : le climat de notre planète.
Certains scientifiques constatent que des glaciers fondent et en concluent
que la planète se réchauffe.D'autres scientifiques constatent
que certains glaciers dans les Alpes, ne fondent pas, mais augmentent
de taille.
Quelle peut alors être la conclusion « intelligente »
de la situation ? (c'est à dire, quelle peut être
la conclusion la plus proche de la réalité, par delà
les peurs, par delà les passions, par delà les luttes
de pouvoir)
A l'échelle de la planète (en prenant la moyenne des températures
sur tout le globe), la température augmente. Mais lorsque dans
certains endroits la température augmente, certains courants
climatiques se modifient, et génèrent des températures
plus froides dans d'autres lieux.
Pour déterminer où
est « la connerie », où sont « les
erreurs » lorsque le sujet est un élément matériel
(relevés de températures, glace ou eau présente
ou non, etc) la présence effective ou non de cet élément
matériel (chiffres, objets) permet de savoir où est la
réalité.
Mais lorsqu'il s'agit de « valeurs d'importance »
que chaque humain accorde à ces éléments physiques
(exemple : un auto-radio est-il plus utile qu'un toit ouvrant,
faut-il manger de la viande ou s'en priver, etc.) comment savoir « où
est l'erreur » ?
La valeur que l'on accorde à tel ou tel élément
est fonction du vécu de chacun, ainsi que d'autres éléments
comme la génétique.
Faut-il croire en dieu ?
Faut-il ne pas croire en
dieu ?
Si nous sommes
seuls sur un territoire, nous pouvons tout faire, tout penser. Mais
nous ne sommes jamais vraiment seuls ! Nous sommes même de
plus en plus nombreux sur la planète. Et notre vie dépend
également de personnes à l'autre bout de la planète
que nous ne connaissons même pas ! (surtout si ces personnes
possèdent des armes capables de voyager par delà les océans).Où
s'arrête la liberté de chacun ? Là où
la liberté des autres commence ? Mais où est précisément
la limite ? L'équilibre est-il possible ? L'équilibre
est-il une fausse bonne solution ?
Et nos pensées, sont-elles si désorganisées que
cela ?
Menu
haut de page
Qu'est-ce qui reste vrai dans tout le bazar de notre monde ?
Notre société est inondée sous les informations
les plus diverses, elles sont souvent gravement déformées
par leurs annonceurs, alors comment les digérer ? Ou comment
gérer notre existence face à ces déferlantes ?
Comment ne pas tomber dans l'excès inverse et voir du danger
partout ?
Depuis toujours l'humain se pose des questions sur ses priorités.
Elles sont parfois d'ordre juridique, parfois morales, parfois religieuses,
parfois sans « ordre apparent ». Sans oublier
la principale priorité peut être : la priorité
économique.Déjà au niveau d'un humain, il est difficile
d'identifier correctement ses priorités, mais lorsqu'il s'agit
de plusieurs humains, c'est à dire d'une société,
identifier clairement les priorités devient quasiment impossible.
Pourtant, notre cerveau répond aux questions consciemment ou
inconsciemment.
Menu
haut de page
N'y a-t-il
pas un ordre prioritaire quelque part ?
Ce livre utilise différents dialogues, différentes situations,
afin de « mettre à plat » les problèmes
existentiels de l'humain, quel que soit son âge, son sexe, son
origine sociale, sa couleur de peau, etc.Et en mettant à plat
tous ces éléments, l'un d'eux apparaît comme dominant :la
survie.
« Il était en pleine jungle, il a survécu aux
bêtes venimeuses.Elle était dans sa chambre, elle a survécu
à une explosion de gaz.Elle aimait « l'amour de sa
vie » passionnément, ce dernier l'a quittée,
elle n'a pas survécu.Il adorait la musique, on l'a privé
de musique, il n'a pas pu supporter une telle vie. Sa survie passait
par la musique. La sophistication de notre société
nous fait souvent croire que nous sommes au dessus d'éléments
simples, que nous ne sommes plus dépendants de « choses
menaçant notre survie ». Or la notion de survie est
beaucoup plus subtile qu'il n'y paraît. »
Menu
haut de page
Qu'est-ce que le survisme ?
Non, ce n'est pas un truc
étrange et indéfinissable ou une secte. Mais le dire ne
suffit pas, surtout dans un monde à tendance paranoïaque
où toute chose nouvelle est « suspecte ».
Sans oublier que d'autres points de vue (psychanalytiques, mouvements
obscurantistes, etc.) veulent faire taire « le survisme »
car ce dernier nuit à leurs intérêts économiques,
et ces « concurrents » n'hésitent pas à
mentir. Pour que les choses soient limpides, voici la définition
du survisme, puis celle de secte. A vous de comparer.
Le survisme
est le nom d'une approche de la psychologie humaine basée
sur « la survie » :
Notre cerveau est un moyen d'analyser des informations.
Ces informations sont de plusieurs sources : les 5 sens (vue, ouïe,
odorat, toucher, goût) et le 6ème
sens (l'imaginaire).Selon
l'approche du survisme, ces informations sont analysées suivant
cet unique classement : assure ma survie / menace ma survie.
Un peu comme les « 0 » et les « 1 »
de l'informatique, le courant passe, le courant ne passe pas. De cette
base très primitive en apparence, on arrive à faire des
choses extrêmement complexes.
Ce classement permanent que fait notre cerveau, permet à l'humain
d'agir : « je fais ce qui assure ma survie, je ne fais
pas ce qui n'assure pas ma survie ».JAMAIS l'humain ne pense
autrement. Il fait absolument toujours ce qu'il croit être le
meilleur pour sa survie.
Ainsi en connaissant cet « ordre de marche »,
on arrive à déterminer quels sont les éléments
qu'un humain a pris en compte pour agir de telle ou telle manière.
Ceci non dans un but de transformer l'humain en pantin, mais au contraire
de le rendre conscient, de lui démontrer qu'il n'agit pas « par
hasard », que lorsque notre voisin a un comportement apparemment
illogique, finalement, son comportement est parfaitement compréhensible,
que lorsqu'une personne a telle ou telle maladie mentale, c'est que
telle et telle information dans son cerveau ont une valeur éloignée
de la réalité, etc.
L'analyse de la cascade d'effets et de causes est lente à effectuée
car il faut être prudent sur les éléments à
prendre en compte, mais une aide nous est précieuse dans cette
analyse :
Quel que soit l'humain, son sexe, sa couleur de peau, ses coutumes,
lorsque des éléments identiques l'entourent, l'humain
agira de la même façon, qu'il habite à New-York
ou en Indonésie.
Comprendre que « tous
nos actes sont liés à la survie » n'est pas
une nouveauté en soi. Mais lorsqu'on va un peu plus loin, annoncer :
« une personne se suicide parce que pour elle, sa survie
passe par la mort », cela étonne. Et pourtant...
De même lorsqu'une personne rit de vous, le premier réflexe
est de se sentir gêné, de se sentir en danger. Or lorsqu'on
comprend les mécanismes du rire (le survisme aide à cette
compréhension), on sait que le rire n'est que l'expression d'une
peur chez celui qui rit.
Précision :
« La gestion des paradoxes » évoque et
précise certains principes liés au survisme, mais le livre
de référence décrivant le traitement de l'information
par le cerveau est « Psychologie, et si on arrêtait
les conneries ? », ISBN N° 2-9526280-0-9 aux éditions
RJTP, disponible dans toutes les bonnes librairies et par internet.
Comment se situe le survisme parmi les Ecoles de psychologie :
Il
faut savoir qu'en matière de psychologie, il y a deux approches
« dominantes » en guerre l'une contre l'autre
(en guerre pour des raisons de luttes d'influences dans les écoles
et pour
des raisons financières).
La première
est « la psychanalyse Freudienne » et toutes
les écoles issues de celle-ci (Lacan etc).
La deuxième
est « les sciences cognitives » ou sciences du
comportement.
La première cherche
à analyser ce qui est dans la psyché mais selon des modèles
de normalité contestés de par ses fondements mêmes,
basés sur des légendes grecques. La notion de perversité
y est omniprésente, or les notions de « bien et de
mal » sont du ressort de la philosophie et non de la psychologie
(voir plus bas les définitions).
La deuxième fait appel à l'observation des comportements
mais généralement ne cherche pas à analyser le
traitement de l'information dans le cerveau.
Le survisme se base sur les
comportements pour comprendre quel est le cheminement de l'information
dans le cerveau, pour analyser quelles informations dominantes sont
présentes.
Comprendre cette approche sert à prendre conscience de ce que
nous sommes.Et lorsqu'il y a maladie mentale (la maladie mentale étant
lorsque le patient est éloigné de la réalité),
cette approche est la plus efficace pour ne pas se perdre dans les mensonges.
Cela se vérifie dans les cas les plus complexes comme l'anorexie,
et les TCA (Troubles du Comportement Alimentaire).
Il faut préciser que
le survisme n'est actuellement pas utilisé dans les secteurs
médicaux pour la raison suivante :
Pour être reconnue,
une approche doit être cliniquement expérimentée.
Mais pour être expérimentée, une approche doit être
déjà reconnue comme valide.
Kafkaïen n'est-ce pas ?
Aucun organisme officiel n'est chargé d'expérimenter quoi
que ce soit de manière systématique. Même le CRNS
ou l'INSERM (en France) ne sont pas là pour répondre à
cette demande. Leurs recherches se font au gré du bon vouloir
des décideurs et des budgets accordés par les Politiques.
Qu'importe, le temps et les échecs des autres approches feront
qu'un jour le survisme prendra sa place. Ne soyez pas les derniers à
l'étudier !
Tout cela pour expliquer que le survisme n'est pas « un ramassis
d'évidences » et qu'il est idiot d'à la fois
se plaindre de « trop d'évidences, déjà
connu », tout en ne comprenant pas que le rire est basé
sur une peur relative (voir explication dans le chapitre spécial),
que l'imaginaire est fondé sur un effet déjà présent
mais mal raccordé à ses causes, etc.
(pour plus d'informations voir le site www.survisme.info
(site totalement gratuit))
Face à la présentation d'une approche nouvelle de la psychologie,
certaines personnes méfiantes ont tendance à utiliser
immédiatement les mots « attention, c'est sûrement
une secte ». Il est bien pour notre survie d'être méfiant,
mais il est également utile de savoir de quoi on parle avant
d'utiliser la peur pour manipuler les autres ou soi-même.
Menu
haut de page
Nuire aux sectes.
Qu'est-ce qu'une secte :
ce terme est souvent employé à tord et à travers,
et sa définition bouge avec le temps (les Chrétiens ont
été considérés comme « une secte »
au temps des romains). Alors où sont les limites vu que
tout groupe d'individus peut être qualifié de « secte »
?
Une secte, c'est avant tout « un repli sur soi-même »
ou seule compte la pensée unique d'un chef ou d'une hiérarchie.
Mais cette définition pourrait faire passer tous les partis politiques
pour des sectes... Un parti politique est-il une secte ?
Il est donc important de préciser que les membres des sectes
utilisent la notion de dieu pour légitimer leur supériorité
sur les autres. Mais
cette précision ne suffit pas car tous les religieux pourraient
être qualifiés de « membres d'une secte ».Les
dernières caractéristiques pour les sectes dangereuses,
sont l'irrespect des libertés de l'individu :Un membre de
secte n'est pas libre de communiquer avec qui il veut et quand il veut.Un
membre de secte donne beaucoup d'argent pour « le fonctionnement
de la secte. ».Un membre de secte doit obéir aveuglément.Un
membre de secte ne mange pas correctement (en quantités suffisantes,
des aliments variés) et ne dort pas 8 heures par jour.
Pourquoi les sectes empêchent-elles leurs membres de dormir tranquillement
et suffisamment ? Pourquoi elles ne permettent pas de manger correctement ?
Parce que : SOMMEIL + BONNE ALIMENTATION = CERVEAU EN PLEINE
CAPACITé de fonctionner.
Or la secte a besoin de robots, de moutons, pas d'humains avec un cerveau
en état de comprendre.
Certains d'entre vous répondront : vu que la société
nous pousse souvent à ne pas dormir correctement (programmes
télés à toute heure de la nuit et du jour), à
manger de façon chaotique (« une petite faim ?
Manger ça tout de suite sans respecter d'horaire ! soyez
libres ! »), à suivre le troupeau (« soyez
à la mode ! »), à donner son argent par
les impôts, sans oublier que nous ne sommes pas libres de communiquer
avec qui on veut quand on veut, à cause de divers facteurs (coûts
des communications, horaires d'ouverture, etc.) alors la société
actuelle peut être qualifiée de secte !
Tout est relatif, mais ne pas oublier que :
Un membre de secte n'est jamais libre de communiquer avec qui il veut
et quand il veut, quel que soit l'horaire.
Alors à vous de vous rendre libre de communiquer et d'échanger
des savoirs quand bon vous semble.
Autre moyen de transformer un humain en mouton : l'obliger à
réciter par cœur avec régularité (dans la
journée ou dans la semaine) des phrases écrites par des
chefs.
Ainsi, par la répétition continuelle, n'importe quel concept
finit par passer dans l'inconscient de l'humain. Si on répète
et fait répéter à un humain qu'il peut finir par
s'envoler en battant très vite des bras, cet humain aura de plus
en plus tendance à prendre cette affirmation pour un fait réel.
Cet exemple peut paraître extrême et irréel, mais
de nombreuses sectes (religieuses ou politiques) font croire à
leurs membres grâce à la répétition continuelle,
qu'ils sont des sur-hommes par rapport à d'autres. Le sont-ils ?
Le survisme est à l'opposé d'une approche sectaire car
le survisme prône de penser par soi-même, de communiquer
librement, d'échanger son savoir, de prendre soin de son sommeil
et de son alimentation.
Les hiérarchies autoritaires qui transforment l'individu en mouton
sont à rejeter.
Le survisme n'a pas de chef, n'est pas là pour vous dire quelles
valeurs doivent être prioritaires. C'est à vous de comprendre,
de vous assumer.
Le survisme n'est qu'un moyen de comprendre vos choix ou ceux des autres.
Certains lecteurs pourront dire « ce n'est qu'un ramassis
d'évidence ». Que ces personnes n'oublient pas que
d'une part, les « évidences » ne sont pas
les mêmes pour tout le monde, et d'autre part que « les
évidences sont relatives ».
Afin de compléter la définition des éléments
en présence (d'appeler « un chat, un chat »)
voici les définitions de « psychologie »
et de « philosophie ». Ces deux étant trop
souvent mélangées dans l'esprit humain, cela entraîne
des interventionnismes qui n'ont pas lieu d'être.
Menu
haut de page
La psychologie
est la détermination
des éléments (des informations) ainsi que leurs valeurs
respectives, présents dans le cerveau. La psychologie décrit
également les mécanismes liés aux interactions
de ces éléments (exemple : pourquoi on a ri ?
Comment naît l'imaginaire, )
La psychologie ne peut pas avoir de sémantique liée au
« bien et au mal ». Pourquoi ?Parce la psychologie
s'occupe de la logique des interactions de valeurs, d'expliquer pourquoi
une personne agit de telle ou telle manière. Juger de la présence
de telle ou telle information dans le cerveau, est du domaine de la
psychologie.Juger du bien fondé de ces présences (exemple
: « penser ça c'est bien, penser cela est mal »)
ce n'est plus du domaine de la psychologie mais de la morale.
Menu
haut de page
Différence entre « penser mal » et « mal
penser »
(équivaut à la différence entre « avoir
le mal en soi » et « commettre une erreur de compréhension »)
« Penser
cela est mal » ce n'est pas comme dire : « cet
élément dans ta tête a une valeur incorrecte (exemple :
tu crois que le soleil tourne autour de la terre, c'est faux) ».Emettre
un jugement de valeurs, (exemple : « si tu es jeune
et que tu laisses ta place assise à une personne âgée,
c'est bien ») est une façon d'organiser la vie en
société. Cette organisation est utile à notre survie
car elle permet de comprendre que le monde ne se limite pas à
notre petite personne, et qu'en pensant aux autres, on permet un respect
mutuel des caractéristiques de chacun. Mais ce jugement de valeur
trouve rapidement sa limite si la morale devient « tout est
dû aux générations plus âgées »,
car dans ce cas, la jeunesse écrasée (survie non assurée)
ne pensera qu'à une chose : échapper aux règles.
Et au lieu d'organiser la société, la « morale »
n'aura fait que créer des tensions et des bases à des
mouvements violents et destructeurs.
Le jugement de valeur se fait dans un autre domaine que la psychologie
: la philosophie.
Menu
haut de page
La philosophie
est la détermination
des éléments prioritaires qui organisent notre vie ou
celle d'autres individus. Ces valeurs prioritaires n'ont pas à
être prouvées comme étant supérieures à
celles du voisin : une personne qui aime la couleur verte plus
que la couleur bleue ne peut pas prouver que son choix est meilleur
que l'autre. C'est un choix, c'est tout.
Exemple pour aider à comprendre la différence entre psychologie
et philosophie :Notre tête est comme une grosse poignée
de billes. Il y a des billes en terre cuite, des billes en verre de
différentes couleurs, de différentes grosseurs. (Les billes
symbolisent les informations présentes dans notre cerveau, informations
plus ou moins fragiles, plus ou moins importantes (que l'on utilise
souvent ou pas)).Les informations se touchent entre elles, comme les
billes dans un sac.
La psychologie, c'est un moyen d'identifier quelles billes sont en terre
ou en verre, leur place, leur importance.
De comprendre la mécanique : que lorsqu'on déplace
une bille d'autres prennent leur place. La psychologie est un moyen
de faire une photo de ce sac.
La philosophie, c'est dire : ceci est mieux que cela, il faut faire
ceci ou faire cela.La bille en verre aux couleurs bleues est plus jolie
donc elle doit grossir pour qu'on la voit plus que les autres. (Exemple :
faire grossir l'information « je suis une personne importante »
en achetant un bien matériel (écran plat aux dimensions
gigantesques) que peu de personnes ont).
La psychologie,
c'est dire : « lorsqu'il y a telle information dans
sa tête, avec telle valeur, et aussi telle information avec telle
valeur, alors il y aura telle réaction. Pour se soigner (pour
avoir une autre réaction) il faut modifier la valeur que l'on
donne à l'une des valeurs car cette dernière n'est pas
réelle. »
La morale, c'est
dire : « il faut faire cela pour être « dans
le bien » il ne faut pas faire cela sinon on est « dans
le mal ». Exemple : avoir des rapports sexuels doit
se faire uniquement dans les liens sacrés du mariage : ça,
c'est le bien. Avoir des rapports sexuels sans être mariés,
ça c'est le mal.
Pourquoi la philosophie religieuse a situé « le sexe
hors mariage » comme étant « nuisible à
la survie ? »
Pour différentes raisons : parce que les religieux aiment
contrôler ce que font les autres, et le mariage est une manière
d'autoriser tel comportement pour telles personnes.
Parce que la transmission de maladies sexuellement transmissibles se
fait très facilement lorsque les humains ont des partenaires
multiples.
Parce que la conséquence d'un acte sexuel peut être la
naissance d'un enfant, et que cet enfant doit pour sa survie, être
entouré d'un environnement stable.
Parce que le désir sexuel est un désir puissant qui doit
absolument être maîtrisé. Etc.
Ces valeurs religieuses, on peut les trouver « bien »
ou « mal », autrement dit, estimer qu'elles assurent
notre survie, ou qu'elles ne l'assurent pas. Mais un même comportement
religieux peut autant « assurer notre survie »,
que la menacer.
Exemple : une personne qui n'est pas satisfaite sexuellement à
qui on interdit d'aller voir ailleurs, peut préférer utiliser
la violence plutôt qu'aller voir ailleurs afin de trouver d'autres
principes lui permettant de se sentir mieux.
Autrement dit, en respectant une valeur qui est sensée « assurer
notre survie », on peut arriver au résultat inverse :
la destruction.
Voilà pourquoi le survisme ne s'occupe pas de dire « il
faut faire ceci ou cela pour assurer sa survie », car tous
les chemins peuvent être bons ET mauvais. Le survisme ne s'occupe
que d'établir les relations cause à effets entre « la
présence d'informations dans notre cerveau, et le comportement
qu'elles engendrent. »
Menu
haut de page
Pourquoi
ce livre
Le Survisme est une approche psychologique, alors pourquoi faire un
livre sur « la philosophie d'un surviste » ?
N'est-ce pas antinomique puisque le survisme prend une photo sans
juger, or la philosophie est sensée déterminer « ce
qui est bien, ce qui est mal » ?
La remarque est importante car l'hésitation à écrire
ce livre a été longue.
Deux éléments ont été déclencheurs
de l'écriture :
1 - La psychologie
est une mécanique, et même si la sémantique utilisée
par le survisme est simple, avec des mots compréhensibles par
tous, cette notion de mécanique est pour certaines personnes
une barrière virtuelle qui les empêche de comprendre le
survisme.La forme « philosophique » étant
plus un dialogue (voir les chapitres suivants), elle rend la compréhension
du survisme plus accessible.
2 - La société
actuelle (des années 2000) semble en perte totale de repères
de fond. Cette perte de repère amène soit à un
refuge dans la culture des apparences, soit dans un retour de l'obscurantisme
(obscurantisme = répondre aux questions sans réponse,
par une réponse unique qui ne doit pas être mise en doute).On
atteint le sommet de l'obscurantisme lorsque la notion de « spirituel »
(le spirituel existe uniquement avec la présence d'un cerveau),
fait croire qu'il ne faut pas utiliser son cerveau.
Il existe de
très très nombreuses philosophies (arts de vivre) dans
notre monde. D'ailleurs, chacun doit avoir SA philosophie de vie.
La philosophie
d'un surviste, c'est une philosophie « cool »
qui peut se résumer par « tous les chemins peuvent
mener à la survie. Donc établir une liste de « choses
interdites » ou « choses à faire parce
qu'elle apporte le paradis ou le bonheur » n'est absolument pas
inutile.La philosophie d'un surviste est une recette pour cultiver le
doute (car remettre en cause ses certitudes est un important facteur
de survie), sans pour autant se noyer dans les doutes (car c'est la
connaissance des faits, la compréhension des argumentaires qui
permet de se construire un esprit fort, équilibré.)
Et cette « recette » qu'est « la philosophie
d'un surviste », cette prise de conscience, commence par :
se voir en face.
Mais « voir les éléments qu'on a dans la tête »
est-il facile ?A-t-on envie de comprendre ce que nous sommes, sans
nous mentir, sans nous auto-manipuler ?
Menu
haut de page
Se regarder
en face, est-ce possible ?
En général, la réponse est non.« je
suis très bien comme ça, inutile de chercher plus loin ! »
Il ne faut pas voir là un nombrilisme exacerbé, simplement
une résistance naturelle face un danger. Quel danger ?Il
y a plusieurs éléments qui gênent notre remise en
question :
1 : notre flemme.
Réfléchir demande un effort, se poser des questions sur
soi est un effort, surtout lorsqu'on essaye de prendre conscience des
suites de causes et d'effets qui interviennent dans telle ou telle situation
passée ou présente. Notre survie passe par l'économie
de l'effort. (Précision : cet économie d'effort est
présente chez tout humain, mais lorsque la valeur « effort »
est associée à « valorisation de notre existence »,
alors faire des efforts n'est plus inutile ou dangereux).
2 : la peur :
Quand on cherche, on trouve. Et que trouve-t-on lorsqu'on cherche dans
« l'âme humaine » ?Des choses que l'on
regrette d'avoir fait ou de ne pas avoir fait, des désirs que
l'on ne comprend pas ou que l'on n'assume pas parce que notre société,
la morale, ou d'autres éléments nous qualifieraient de
« pas bien ».
La peur peut être recherchée (que ce soit des montagnes
russes, de l'alpinisme, des films d'horreur etc), mais cette peur là
reste un « danger maîtrisable ». Les montagnes
russes sont sûres, l'alpiniste soigne son matériel, et
les films d'horreur ont un cadre de « divertissement ».
Ce que l'on a à l'intérieur, on s'en fait souvent des
montagnes, ou ne connaissant pas bien ces zones d'ombres, on les imagine
facilement prendre de l'importance si on fait attention à elles.
Cette dernière idée (réfléchir = danger)
n'est pas à négliger, car réfléchir à
un problème dans de mauvaises conditions (conditions d'urgence,
ou/et ne pas dormir assez, ne pas manger correctement de façon
équilibrée et suffisante, ou réfléchir uniquement
dans son coin, isolé (communication mauvaise, une seule source
d'information (soi ou un groupe homogène) peut entraîner
« l'envie de ne pas réfléchir, car cela ne
m'apporte rien de bon (n'assure pas ma survie) »
3 : la résignation.
Cette résignation à se dire « les choses sont
comme elles sont et je n'ai pas à chercher à comprendre »
peut sembler être une forme de modestie : dire que les choses
dépendent d'un élément plus puissant que moi. D'un
côté, il est vrai que « se prendre pour le centre
du monde » est un mensonge. Nous sommes soumis à des
éléments plus forts que nous (exemple, la volonté
humaine ne peut pas grand chose lorsqu'on est pris dans une tempête).D'un
autre côté, cette « modestie » est
fondée principalement sur les deux éléments précités,
à savoir : la flemme et la peur. Flemme en croyant la tâche
impossible à réaliser, seulement réservée
à des sur-êtres, et peur, peur d'aller voir ce qui est
« interdit de savoir, interdit de comprendre »,
parce que comprendre nous mets dans un stade de « conscience »,
donc, de « responsabilité ». Or, on peut
vouloir fuir les responsabilités.
Menu
haut de page
Paradoxe : conscience = impuissance ou puissance ?
Sur un plan philosophique, la conscience n'apporte souvent que la frustration
de son impuissance : alors pourquoi vouloir être conscient ?
On a beau comprendre une suite d'évènements, les interactions
en présence, changer les choses est-il pour autant toujours
possible ?
Oui, à deux conditions :
Ne pas croire qu'il suffit d'appuyer sur un bouton comme avec la télécommande
de la télé, pour que les choses changent, autrement dit,
il faut savoir apprécier le temps qui passe.
Ne pas se prendre pour un sur-être parce que l'on comprend mieux
les choses que d'autres, autrement dit, rester humble et ne pas oublier
qu'un seul cerveau humain n'a pas la capacité de tout comprendre
dans tous les domaines, que plusieurs cerveaux valent mieux qu'un.
A ce propos
d' « apprendre sans limite », la conscience fait
peur. Parfois, on préfère « ne pas savoir »...Pourquoi ?
est-ce dangereux d'agir ainsi ? Comment faire autrement ?
Il existe plusieurs
raisons pour laquelle on ne veut pas « être pleinement
conscient » des éléments qui nous entourent.
L'une d'elle se résume par la phrase :
La conscience
n'apporte souvent que la frustration de son impuissance.
Parfois on
a beau savoir qu'un météorite arrive, connaître
sa grosseur, sa vitesse, sa composition, n'empêchera pas de se
faire écraser comme des moustiques si ce météorite
entre en collision avec la terre. Et le fait de « savoir »
ce futur angoissant pose la question « est-ce que je ne serais
pas plus heureux si je ne savais pas ? »
C'est bien résumé.
Alors ?
Alors il ne faut pas oublier 2 choses : La première, c'est
qu'un décalage entre les informations présentes dans un
cerveau (informations sensées être le reflet de notre univers
extérieur) et la réalité de ce qu'est le monde,
reste et restera une « erreur ». Et cette erreur,
en terme psychologique, ça s'appelle la souffrance. Et plus on
est en décalage avec la réalité, plus on est « malade ».
La deuxième implication est une conséquence de la première.
Si on croit que notre cerveau est le centre du monde, que s'il « veut »
alors les choses doivent être « comme il veut »,
il ne faut pas s'étonner qu'il n'y ait en finalité aucune
harmonie.Les forces du cerveau ont leur limite.
Donc, « la conscience n'apporte souvent que la frustration
de son impuissance » quand sont associées les informations
« conscience des causes et des effets », et « je
veux, donc ce sera ».
Dans le cas où la conscience est associée à « je
suis humble : je fais de mon mieux mais ne m'appelle pas ATLAS
soutenant l'univers », il y a beaucoup moins de frustration.
Menu
haut de page
Dialogues constructifs
et sans tabous.
Le cercle des profs disparus.
« Pourquoi
êtes vous sur terre ? » demande un prof à
sa classe.
- Parce que
si j'étais en l'air, je tomberais !
- Pour emmerder les profs !
- Pour gagner plein de tunes !
- Pour avoir du plaisir ! Beaucoup de plaisir !
- De la jouissance tu veux dire ?!
- Ha ha ah
Est-ce tout ?
- On est sur terre par la volonté de dieu.
- Mais oui c'est ça ! Et les milliards d'années d'évolution
tu en fais quoi ?
- Elle n'explique pas le début ! Comment est née
l'évolution ?!
- Par le big bang !
- Mais ce big bang, qui te dit qu'il n'a pas été fait
par dieu ?
- Et dieu alors ? Qui l'a fait ? Il s'est créé
tout seul ? T'en sais rien ! Alors arrête de dire des
conneries !
Ho la !
On se calme ! Chacun a le droit de penser ce qu'il veut, pas la
peine d'en venir aux insultes.
- Et les extrémistes
religieux ? Vous croyez qu'ils laissent dire ce que l'on veut ?!
Les extrémistes
quels qu'ils soient, ne laissent pas les autres s'exprimer.
Personne n'a le monopole.
Mais revenons au sujet : « c'est quoi la vie ? »
- La vie c'est une lutte entre les extrémistes, avec nous au
milieu ! Et les extrémistes nous cassent les couilles !
Ras le bol !
Donc la vie se résume à une lutte ?
- Oh hé la lutte finale on sait ce que ça a donné !
La lutte des « classes » c'est une utopie !
- Et les castes en Inde alors ?! ça existe toujours et ce
n'est pas près de s'arrêter ! c'est une réalité
ça !
- Mais une lutte n'est pas forcément liée à un
groupe ! Moi je lutte contre le bocal de cornichon qui ne s'ouvre
pas, et bien c'est une lutte avec le couvercle !(rire des autres
élèves)
Ton exemple est humoristique, mais il y a du fond quand même.Car
cette lutte pour obtenir un cornichon, est motivée par quoi ?
- Par ma faim.
- Ou par ta gourmandise !(rires)
Et si tu n'obtiens pas le cornichon ? Que deviens-tu ?
Je suis mort !(rires)
Tu as donc agit quelque part... pour ta survie ?
- C'est un peur fort comme terme ! Je n'allais pas mourir de ne
pas obtenir ces cornichons !
Parce que
tu n'étais pas dans un désert seul avec tes cornichons
dans le bocal, mais quand tu étais dans ta cuisine, le bocal
dans les mains, n'étais-tu pas dans un désert avec cette
unique pensée : « J'ai besoin de ces CORNICHONS !
» ?
- Oui mais ce n'était pas vital pour lui.
- Ben si, je les voulais vraiment ! Mais vital...
- Ce n'est pas Bouddha qui disait qu'il fallait chasser ses désirs
pour vivre librement ?
Il disait un truc de ce genre. Pour lui, vivre, ça passait
par une certaine approche de la vie.Mais connaissez-vous la vie de Bouddha ?
-Vous allez faire de la pub pour le bouddhisme ?
Il n'est pas question
de dire « suivez tel ou tel exemple », il est
question de voir les différentes façon d'agir, pour mieux
comprendre comment nous, on agit.
- C'était un riche, un roi !
- N'importe quoi il était pauvre !
Dans sa jeunesse il était immensément riche, puis il
a décidé ensuite de vivre dans la pauvreté totale.
Alors pour certains d'entre vous dont la principale occupation est d'avoir
« de la tune », comment comprenez-vous cela ?
- C'était un malade ! Moi je n'aurais jamais fait ça !-
Si vous espérez qu'on va faire comme lui, vous vous fourrez le
doigt dans l'œil !- Il pouvait peut être se le permettre
d'être pauvre ?! il n'avait peut être pas d'enfant
à charge ou n'était pas marié !
Si, il l'était et avait un fils.
- Il ne devait pas beaucoup les aimer pour les quitter !
Sa priorité n'était pas celle là. Cet homme
avait tout, et il est parti. Alors selon-vous, quelle était sa
motivation ?
- Il s'est peut être passé un événement dans
sa vie juste avant qu'il parte !
Effectivement. Il a été confronté à la
mort, à la misère, aux souffrances des autres. Et ça
l'a touché.
- Si c'était un mec riche, il aurait dû donner son fric
aux miséreux ! ça aurait été plus cool
que de se barrer !- Oui mais après avoir donné tout
son fric, il aurait fait quoi ?
C'est peut être un problème ! Même s'il avait
donné tout son argent, cela n'aurait pas suffit à amoindrir
la misère humaine, et ça, il devait le savoir. Alors que
faire ? Qu'auriez vous fait à sa place ?
- J'en aurais rien eu à faire des pauvres !(rires)
- Peut-être qu'il voulait chercher à contrer la misère
mentale ? Et cette misère ne se contre pas en donnant de
l'argent ?!
Qui sait ? Peut-être que sa motivation était là !Peut-être
qu'il a cherché la plénitude ailleurs que dans les richesses
qu'il possédait !
- C'est débile ! Quand on est riche et qu'on a tout, et
bien on nage dans la plénitude !
- N'importe quoi ! si c'était le cas, il n'y aurait pas
de riches qui se suicideraient !
- T'en connais beaucoup toi, des riches qui se suicident ?
- Comment tu veux que je sache ? Je ne connais aucun « riche »
!(rires)
- Ouais mais y'en a beaucoup qui se droguent, et on ne se drogue pas
quand on est en paix et qu'on se sent bien ! On a pas besoin de
ça !
Alors, pour être heureux, il faut être riche ? Pauvre ?
Aisé ?
- Il faut être aisé ! Avoir de quoi se payer ce qu'on
veut, mais pas trop, pour continuer à avoir du désir et
des choses inaccessibles ! Comme ça, ça motive à
avancer !
- Mais Arrête de faire ton philosophe ! Avancer vers quoi ?
C'est vrai ça ! Avancer vers quoi ? Vers le futur ?
Vers le bonheur ?
Le bonheur ça doit être une carotte en permanence devant
soi ? Un truc que l'on rattrape de temps en temps, puis « hop !
» ça disparaît ?
...
- Le bonheur, ce n'est
pas comme la plénitude !
- Mais si c'est pareil !
Menu
haut de page
|
|