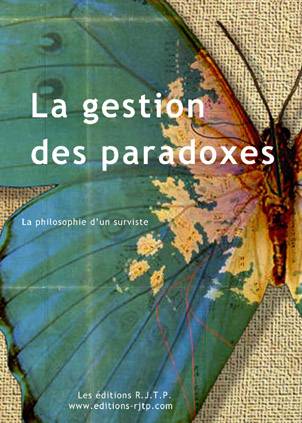|
Gérer
la mort
Paradoxe
: l'impensable doit être pensé
Gérer
la mort, est-ce possible ?
Toute
chose qui existe finit par disparaître. Pourtant notre ego nous
fait souvent croire l'inverse :
« tu es
immortel, les accidents c'est pour les autres, ça ne peut pas
t'arriver ! »
Mais
l'inexistence de ce qui a existé (la mort) n'a que faire de notre
ego sur-dimensionné.
Alors comment gérer
la mort des autres, comment gérer sa propre mort ?
Commençons
par décrire pourquoi la mort est perturbante.
1er
cas : la mort des autres.
Le
monde est ce que notre cerveau en perçoit. Il reçoit des
informations tout au long de sa vie, et le cerveau construit son monde
en tissant des liens entre les informations reçus et les informations
imaginées.
Certaines informations
ont plus de « valeurs » que d'autres. Les être
vivants que l'on connaît et que l'on apprécie ont plus
de valeur que des objets usuels comme des verres à eau, des fourchettes,
etc.
Pourquoi cette différence
?
Parce que les êtres
vivants que l'on apprécie ne sont pas interchangeables et sont
rares.
Ils deviennent des
éléments qui occupent notre esprit régulièrement.
Et lorsque l'un de
ces éléments disparaît, le cerveau se sent perdu,
sa propre « survie » lui semble menacée.
Comme si, dans un mur, on enlevait des pierres à sa base : le
mur est fragilisé.
Et la mort est souvent
source de traumatismes, faute de savoir gérer le vide laissé.
Chose étonnante
: très peu d'écoles enseignent différentes manières
de gérer la mort.
Il est peut-être
temps pour l'humanité, d'affronter tous ses tabous.
2ème
cas : notre propre mort.
On
est là, puisque l'on pense. (Puisque l'on pense être).
Alors il n'y a aucune raison pour que ça change ! Surtout lorsqu'on
se sent bien, que l'on aime exister.
Seulement voilà,
aucun élément vivant ne survit indéfiniment. Même
la matière non vivante peut se disloquer, s'atomiser.
Et
lorsque l'on prend conscience de la mort, de notre mort (à cause
de la mort d'une personne que l'on aimait, à cause de notre capacité
à imaginer ce que serait « la vie de nos proches »
sans nous, etc), on se met à avoir quelques sueurs froides, presque
à paniquer... Puis généralement on occupe notre
cerveau avec d'autres éléments, et on oublie ce sujet
sensible, jusqu'à la prochaine confrontation avec ce problème.
Quoi qu'il en soit,
depuis des millénaires l'humain répond a ce problème
par différents moyens plus ou moins maladroits :
1-
la fuite
2-
la reproduction (continuité temporelle)
3-
laisser une trace en entrant dans l'histoire
4-
l'idée de vie après la mort
5-
la lutte contre son ego
1-
la fuite
Le cerveau humain peut, face
à un problème difficile à résoudre, chercher
à oublier par l'étouffement.
Notre
cerveau est fait pour analyser en permanence des causes et des effets,
tisser des liens entre les informations. Mais un problème insoluble
étant une information que l'on arrive pas à lier correctement
à d'autres, le cerveau peut masquer son échec en s'occupant
de plein d'autres choses à la fois, afin de ne jamais avoir une
seule seconde au repos, repos qui pourrait laisser exister ce « problème
non solutionné », comme un fantôme qui revient
dans le silence.
Et plutôt que
risquer des silences, le cerveau se crée des besoins, une course
sans fin.
Voilà pourquoi
certaines personnes se « noient » dans le travail,
font du sport dès qu'ils ont 5 minutes, ont une passion dévorante,
etc.
La
fuite en avant plutôt que prendre le temps de réfléchir
à la problématique de la mort.
2-
la reproduction
L'un des moyens pour
ne pas disparaître est... de continuer à vivre. Non ? Sauf
que les cellules fatiguent et meurent, sans forcément arriver
à se régénérer. Aussi, donner la vie est
un très bon moyen de « mettre une part de soi »
dans un être neuf, capable de survivre quand les parents seront
morts.
« Oh, ton
enfant a tes yeux, il a ta bouche... »
Chouette, une part
de moi va continuer à exister après ma mort ! Mais...
Le physique ne suffit pas, il faut également que survivent certaines
de mes pensées. C'est pourquoi je vais transmettre mes valeurs
à mon enfant. Je vais l'éduquer, autant pour qu'il sache
se débrouiller seul après ma mort, que pour qu'il défende
mes idées à travers le temps. Ces idées peuvent
être de tout ordre : politique, recettes de cuisine, religieuses,
etc.
Evidemment,
notre ego nous fait croire que « puisque l'enfant est issu
de nous, il est une part de nous ». Mais l'enfant est avant
tout un nouvel être, unique, dont les « liens du sang »
ne sont qu'image intellectuelle (si un parent transmet son sang à
un enfant, l'enfant a toutes les chances de mourir empoisonné
par le sang de son parent, faute d'un groupe ou rhésus sanguin
compatible).
Bon nombre de parents
ont du mal à transmettre leurs valeurs et il arrive souvent que
ce soient les idées inverses que l'enfant développe, dans
un souci de se « trouver lui-même ».
Mais
la reproduction reste l'un des moyens le plus simple pour donner à
l'humain l'idée d'immortalité.
Attention, cette conclusion
ne doit pas faire croire que c'est l'idée d'immortalité
qui engendre la reproduction. C'est le plaisir sexuel et d'une manière
générale la chimie du cerveau (les manques sexuels : le
fait « d'être en chaleur », le débordement
de testostérone) qui sont à la base des actes sexuels
d'au moins un des partenaires et engendre le fait que depuis la nuit
des temps les animaux et les humains se reproduisent.
3-
laisser une trace dans l'histoire
La reproduction n'étant
pas un moyen sûr de continuer à exister (l'enfant restant
finalement le seul maître de son avenir), certains individus préfèrent
entrer dans la mémoire collective, cette dernière étant
sensée être moins volatile que la mémoire d'un seul
individu.
Alors comment entrer
dans la mémoire collective ?
En marquant les esprits
par des actes qui sortent de l'ordinaire, en montrant sa puissance,
etc.
Cela
va du « simple peintre du dimanche » au dictateur
le plus impitoyable, en passant par les inventeurs, les politiciens
voulant changer la face du monde, etc.
L'individu sait qu'il
laissera une « trace immortelle » dans l'histoire
lorsque son nom et son oeuvre entrent dans le dictionnaire. Evidemment
le support peut changer : certains préfèrent le marbre
au papier. Mais le principe reste le même : placer des bouts de
soi dans un support moins mortel que soi-même.
4-
l'idée de vie après la mort
L'une des façons
la plus simple de ne pas être soumis à l'inexistence, c'est
de croire en l'immortalité.
Si le cerveau est gêné
par une information, après tout, pourquoi ne pas faire comme
si cette donnée n'était pas vraie ?
« La mort
me terrifie ? Alors faisons comme si la mort n'existait pas. »
De
cette idée centrale, de nombreuses possibilités s'offrent
à votre cerveau :
Vous pouvez imaginer
un paradis fait de vierges, d'anges, d'ancêtres, etc.
Vous pouvez imaginer
une boucle sans réelle fin : la réincarnation.
Vous pouvez imaginer
la transposition dans une autre dimension totalement inconnue et dépassant
l'imaginaire humain.
Il
est inutile d'apporter des preuves de l'existence ou de l'inexistence
de la vie après la mort puisque le fondement de cette idée
est la croyance et que tout se passe dans le cerveau de l'humain vivant.
Rappelons qu'une idée
n'a pas à être « prouvée ».
Une idée, il suffit de l'émettre pour qu'elle existe.
Mais une idée
n'est rien de plus ou de moins qu'une idée.
5-
la lutte contre son ego
Cette approche est probablement
la moins démagogique et la plus délicate à utiliser.
Pourquoi délicate
? Non pas qu'elle soit dangereuse, mais elle est fragile.
Il
s'agit dans un premier temps de comprendre que dans l'univers, l'humain
est absolument rien du tout (concept que l'ego n'apprécie pas).
« Rien du tout » ou presque, car l'humain a un
effet sur son environnement. Et si c'était sa volonté,
l'humain pourrait très bien détruire plus que sa planète...
Mais quoi qu'il en
soit, la place de l'individu humain dans la globalité de l'univers,
est plus qu'infime. Et c'est une chance pour lui dans le sens ou « vivant
ou mort », il n'y a pas beaucoup de différence pour
l'univers. La mort de l'individu n'est donc pas un drame. Evidemment
à condition de ne pas se croire le centre de l'univers...
Dans
un deuxième temps, il s'agit d'analyser ce que la « masse
de carbone et d'eau » que nous sommes, est par rapport au
reste des atomes qui composent l'univers.
Quand on met en présence
d'une roche calcaire, un acide corrosif, que se passe-t-il ?
Il
y a une réaction chimique.
Lorsque l'on met des
acides aminés ensemble, on crée la vie. Il y a une réaction
biologique.
Lorsque l'on met certains
produits dans le sang et que ces produits atteignent le cerveau, il
y a des réponses chimiques.
Lorsque l'on met une
plante vivante au soleil, la photosynthèse transforme les cellules,
il y a transformation chimique.
Lorsque l'on place
un humain dans un environnement, il agit sur ce dernier.
Alors
pourquoi ne pas considérer l'humain comme une propriété
physique et chimique de l'univers ?
Evidemment,
l'humain est un être complexe qui ne se compare pas directement
à une simple roche, mais il répond à des mécaniques.
Il réagit en présence de certains éléments.
Evidemment le hasard de l'évolution a joué sur son existence,
comme tout élément de l'univers qui continue d'exister
si et seulement si un autre élément ne vient pas le détruire...
Et si l'humain n'est
qu'une propriété physique et chimique de l'univers, il
est englobé dans un tout (l'univers) qui lui, est (à l'échelle
de la race humaine) éternel. La mort n'a donc aucune importance
puisque le reste continue d'exister.
Il
reste enfin l'approche « carbone ».
Nous sommes constitués
en grande partie de carbone.
Le carbone est un atome
issu des étoiles et de leur combustion, et ce carbone est recyclé
à l'infini dans de la roche, roche nourrissant les végétaux,
puis ce carbone passe des végétaux aux animaux et aux
humains, et les humains repartent dans la terre...
Comme nous sommes fait
d'atome de carbone, certains de ces atomes en nous ont servi pour faire
des végétaux, pour de la roche, pour des animaux, etc.
Le tout dans un cycle infini.
Nous
sommes donc en partie éternels.
Et
contrairement à certaines idées précédemment
citées, l'approche « carbone » est un fait
avéré, il n'est pas du domaine de la croyance. Est-ce
que pour autant cette approche « carbone » fera
que l'humain sera moins effrayé par le fait de disparaître
un jour ?
C'est à chacun
de se poser la question, et surtout de vouloir ou non y répondre.
|