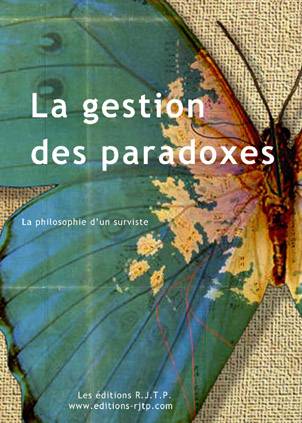|
|
Gérer la violence Paradoxe : par la non-violence ou par une violence plus forte ?
Tu parles de « se faire violence », mais je trouve que cette notion est opposée au bonheur. Alors, la violence, c'est quoi ? Le
survisme démontre que la violence naît d'un profond sentiment
de « survie non assurée ». Mieux qu'interdire ou légitimer la violence : la comprendre. L'un
des paradoxes de la violence est qu'elle donne une impression de « survie
assurée ». C'est celui qui gueule le plus fort qui
l'emporte, c'est celui qui frappe le plus fort sur la table qui donne
l'impression d'avoir le pouvoir. Mais suivre celui qui donne l'impression
« d'être puissant » n'assure pas forcément
notre survie. L'humain violent a un sentiment de puissance mais la violence
n'est pas une preuve de raison. Où commence la violence ?
Il
faut tout d'abord déterminer où commence la violence.
La
violence mentale est formée par deux informations dominantes
qui s'affrontent : Résultat : la situation est insupportable. Comment faire pour que l'information dans notre tête domine l'information extérieure ? En
« tuant » la source de l'information extérieure
? En
« argumentant » face à la source d'information
extérieure ? Dans
cette catégorie « argumentaire », il y
a deux types d'individus : La valeur d'une information est-elle modifiable ? C'est
quoi modifier les valeurs d'une information ? La valeur d'une information est donc modifiable. Mais
certaines informations sont tellement « certifiées
comme sûres » que lorsqu'on est face à une nouvelle
information qui nous prouve que finalement on s'est trompé, notre
premier réflexe est de ne pas croire à cette nouvelle
étiquette (étiquette « survie »
ou étiquette « pas de survie »). Il en va de même pour les personnes souffrant de maladie mentale comme l'anorexie, et qui se sont répétés pendant des années qu'elles étaient coupables, nulles, etc. Pour qu'elles guérissent, il faut qu'elles changent la valeur de ces informations, ces changements leur paraissent impossibles à effectuer ! Pourtant, toute information est toujours modifiable, à condition que la nouvelle place de l'information soit harmonieuse, ait une place qui fait que l'on comprend, que les informations entre elles, s'emboîtent bien. Evidemment, certaines informations sont plus facilement modifiables que d'autres (comme vu précédemment). La valeur d'une information est-elle subjective ? La
valeur d'une information est subjective dans le sens ou chacun lui donne
la valeur qu'il veut : Mais
pour chaque individu, cette valeur n'est pas du tout subjective. « Dire les choses telles qu'on les pense » à une personne qui ne veut pas entendre autre chose que ce qu'elle pense déjà, est une forme de contrainte, donc de violence. Alors comment trouver le juste équilibre ? Il
y a quelques temps, les caricatures de Mahomet ont, pour certains, franchi
les limites de « la liberté de dire ce que l'on veut. »
Comment départager ces deux cas : - Une personne se sent agressée lorsqu'on parle de son dieu ou prophète dans des termes qui ne sont pas élogieux et elle réclame une punition pour toute personne qui l'agresse ainsi. - Une personne ne croyant pas en dieu, entend une personne qui annonce avec force « dieu est grand » ou « grâce à dieu » ou « si dieu le veut bien » (etc), se sent agressée par ce point de vue. Les deux individus sont dans le même cas : il y a contrainte dans le sens où l'individu a entendu quelque chose qu'il ne voulait pas entendre. Notre liberté s'arrête où celle des autres commence. Par
conséquent, ne fait pas à un autre ce que tu n'aimerais
pas qu'il te fasse. Mais
ce principe d'égalité de traitement ne pose pas clairement
les limites de la liberté car en appliquant ce principe jusqu'à
l'extrême, on pourrait finir par ne plus rien oser faire de peur
de froisser. Cette attitude est celle adoptée par les religions
ou groupes qui veulent que « aucune tête ne dépasse »,
avec le principe : « surtout ne pas se faire remarquer ».
Elle a pour conséquence de privilégier ce qui existe déjà
et interdire tout ce qui est nouveau (société de conservateurs).
Sachant que le monde évolue (augmentation de la somme des connaissances,
techniques, évolution de l'environnement, etc), la survie semble
donc passer par une adaptation plutôt que camper sur ses positions.
Alors,
où commence et ou finit la survie ? Sachant que « ne pas changer d'un poil » est lié à la peur du changement ou au risque de « perdre » et que cette peur empêche l'individu d'évoluer, d'augmenter son savoir, alors la philosophie surviste tend à préférer « l'adaptation aux nouvelles données. » Compliqué tout ça ? Attendez,
voici encore un élément pour compliquer le tout :
« l'adaptation aux nouvelles données »
ne veut pas dire « courir après la dernière
technologie en date ». Notre liberté s'arrête où celle des autres commence. Rappel : Si un homme dit que la femme doit avoir tel ou tel comportement, et sera punie si elle n'agit pas ainsi, il doit pouvoir accepter qu'une femme lui dise qu'il doit avoir tel ou tel comportement et qu'il sera puni de la même manière s'il transgresse cette règle. Mais rapidement cette « égalité de traitement » met au jour le problème réel : Derrière ces luttes, il y a évidemment « la survie » mais également une notion que l'on n'aime pas aborder à cause de l'Histoire humaine (et plus précisément du Nazisme), la notion d' « être supérieur ».
|
|
Téléchargez gratuitement ce livre numérique en format PDF ! Vous pouvez également
le visionner directement
|
||